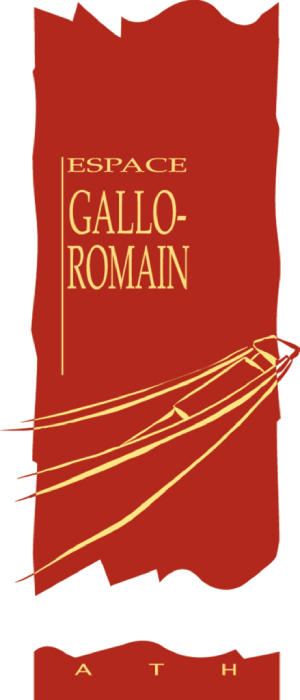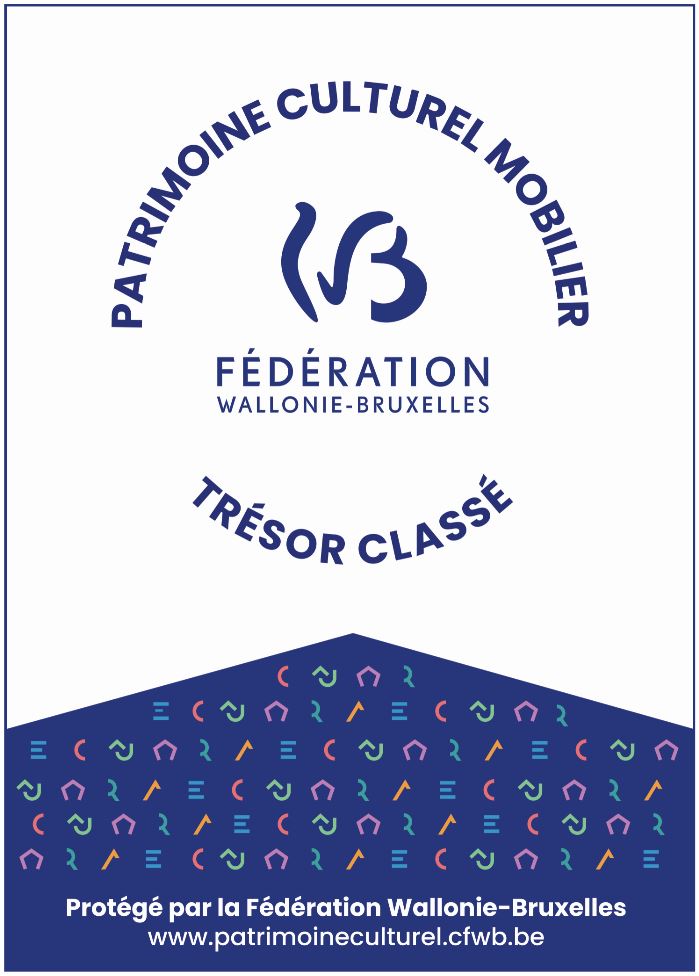Les collections
L’Espace gallo-romain expose et conserve diverses collections archéologiques régionales issues de fouilles et prospections réalisées dans la région athoise et autour de Pommeroeul.
Ces collections, en majorité datées de la période gallo-romaine, sont très variées : objets en cuir, en verre, en céramique, en bois, en métal. On y retrouve autant des objets de la vie quotidienne comme de la vaisselle, des chaussures, des outils mais aussi des pièces hors normes et rares : des bateaux, des épées, des statuettes, …. Le chaland et la pirogue en sont sans conteste les pièces majeures !
Le chaland est d’ailleurs reconnu comme Trésor par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pommeroeul : une agglomération porturaire
C’est au cours de l’été 1975, qu’un site gallo-romain d’importance internationale est mis au jour à 2,5m de profondeur à Pommerœul, près de Bernissart. Les vestiges permettent de révéler un site occupé de la période néolithique à l’époque romaine. L’occupation la plus importante se dévoile sous la forme d’une agglomération gallo-romaine située au croisement d’une route (Bavay-Blicquy) et d’une rivière (La Haine). Une situation qui lui conféra probablement un rôle commercial et artisanal prépondérant pour les régions situées au nord de la ville antique de Bavay. Pommerœul était doté de zones portuaires, d’habitations et d’artisanats, de puits, de nécropoles, etc. On peut dater l’occupation romaine du Ier siècle avant J.-C. au IIIe siècle après J.-C.
1975-2025 : 50 ans des fouilles
Les collections appartiennent à divers propriétaires dont la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Service Public de Wallonie. Elles sont complétées par des objets mis en dépôt par le Cercle Royal d’Histoire et d’Archéologie d’Ath et de la Région, par des propriétaires privés ainsi que par des pièces archéologiques appartenant au musée et à l’ASBL Office de Tourisme d’Ath. Nous conservons également les archives des fouilles de Pommeroeul et d’autres sites dont le matériel nous a été confié. Ce volet archivistique et numérique est composé des carnets de fouilles, plans, relevés, dessins, dias, négatifs & photographies.
Le musée comporte un centre de documentation, accessible sur rdv, qui enrichit et documente les thématiques abordées ainsi que les collections par des publications variées, qu’elles soient scientifiques ou de vulgarisation, générales ou régionales.

L’Espace gallo-romain accueille le public depuis 1997 au cœur de la ville d’Ath. Le musée s’est installé dans l’ancienne Académie de Dessin, derrière une belle façade néoclassique.
nos collections
les incontournables
le chaland et la pirogue
entre le 1er et le 2e siècle de notre ère
Le chaland et la pirogue sont sans conteste les pièces majeures du musée.
Le chaland (daté du tournant des 1er et 2e siècles de notre ère) a été conservé sur une longueur de 12,70 m (18 à 20 m à l’origine) ; la pirogue « monoxyle » en chêne mesure 9,70 m (12 m à l’origine), elle est datée du 1er siècle.
Découverte archéologique ?
Une découverte archéologique ? Suivez la marche à suivre
INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE
Rue de Nazareth, 2
7800 Ath (Belgique)
HORAIRE
Ouvert en été (du 1er avril au 30 septembre) du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h. Les week-ends et jours fériés de 14h à 18h.
Ouvert en hiver (du 1er octobre au 31 mars) du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h.